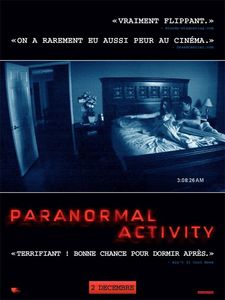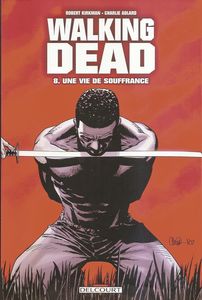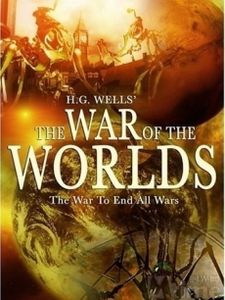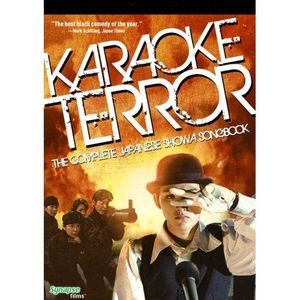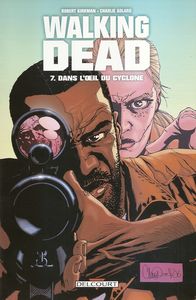Paranormal Activity
Sortie en salle
PARANORMAL ACTIVITY
de Oren Peli (2009)
Alors la voilà donc, la terreur des salles obscures! le film qui a plongé l'Amérique dans une frayeur sans nom! la trouille bleue de la décennie! le nouvel "Exorciste"! qui arrête les pacemakers! déflore les vierges par osmose! fait cailler le lait des parturientes! abandonne le spectateur bloblottant entre les bras des infirmiers compatissants! à ne pas visionner sans un pompier à proximité, prêt à intervenir juste au cas où…
À mon humble avis, c'est très exagéré, si j'en juge par la fine équipe de minots (niveau CM2) installés juste derrière moi dans la salle, et qui m'ont copieusement pourri la séance avec leurs incessantes vannes de cour de récré… Z'avaient pas vraiment l'air traumatisé, non plus que les exactions du poltergeist facétieux ne leur avait coupé l'appétit, ni même interrompu une seconde le vigoureux grignotage de sucreries variées! Ou alors, c'est que tous ces braves ménagères yankees qu'on peut contempler terrifiées lors d'une sneak-preview, dans un trailer pour le moins autosatisfait, n'ont pas vu grand chose de leur vie… Vous me direz, si tous les produits, filmiques ou non, étaient à la hauteur de leur promo, nous vivrions tous au paradis des consommateurs…
Bon, nonobstant les nuisances sus-décrites et inhérentes au public du samedi soir (pas le choix: deux séances dans la semaine en tout et pour tous, ainsi va la vie du fantasticophile de province!) qui m'empéchèrent de m'immerger dans le film de façon satisfaisante, je dois vous avouer que, si "Paranormal Activity" est loin de vous perturber la tripaille sans vous laisser de répit, et encore moins de vous empêcher de dormir comme on nous l'avait pourtant promis (remboursez!), ça n'en reste pas moins une œuvre très prenante, quoique roublarde, avec de vrais morceaux de trouille dedans. Reste à voir si, dans le genre quelque peu surpeuplé "shaky-cam subjective", le film d'Oren Peli parvient à tirer son épingle du jeu, après "Le Projet Blair Witch" (Daniel Myrick & Eduardo Sanchez - 1999), "Diary Of The Dead" (George A. Romero - 2007), "Cloverfield" (Matt Reeves - 2008), et enfin le phénomène "Rec" (Jaume Balagueró & Paco Plaza - 2007), son remake (tout pourri) et sa séquelle (intéressante) - et je ne parle pas des diverses expériences "dogmatiques" initiées par Lars Von Trier…
À mon sens, le principal atout de "Paranormal Activity" réside dans les fameuses séquences en plan fixe et en noir et blanc, celles où une caméra automatique veille sur le sommeil des protagonistes. C'est même là, s'il en est une, la véritable innovation par rapport à la longue série de "documenteurs" que j'ai énumérés. Le fait qu'aucun personnage ne soit censé tenir la caméra, abolissant par là-même tout effet de mise en scène, confère à ces séquences un surcroît de réalisme glacé et glaçant. Cette idée, fort astucieuse si ce n'est géniale, prend en effet le parfait contrepied de la trop fameuse caméra subjective, remplacée par une caméra qu'on pourrait qualifier d'OBJECTIVE et qui, en débarrassant l'acte de filmer de tout état d'âme lié au caméraman, gagne un pouvoir immersif étonnant en suspendant quasi instantanément l'incrédulité du spectateur. Entre paranthèses, j'en viens d'ailleurs à supposer qu'avant même que l'on songe à mettre en scène des photographies puis des films, c'est peut-être pour cette raison étymologique que l'on nomma OBJECTIF l'appareillage servant à capturer des images, et censé restituer le réel dans toute sa froideur… Quoi qu'il en soit, l'effet est imparable, et les images prennent dès lors un statut de témoignage incontestable, au même titre que celles stockées par les très controversées caméras de surveillance, nous suggérant par là-même que ce qu'elles nous montrent a une réelle valeur documentaire. Nous adhérons dès lors sans réserve à ce postulat fictionnel, quel que soit par ailleurs notre degré de scepticisme.
Si ces séquences pseudo objectives s'avèrent d'une réelle efficacité, c'est aussi qu'Oren Peli nous les délivre avec un art consommé de la gradation. Ainsi, lors des toutes premières "scènes de nuit", bien que l'on n'ait rien à se mettre sous la dent, si ce n'est des dormeurs remuant de temps à autre, ce "rien" est déjà "tout". En effet le spectateur, cherchant une diversion à un ennui machiavéliquement provoqué, scrute le cadre dans tous ses recoins. Son attention est captée sans coup férir, mais surtout, il a été mis en condition quasiment à son insu. Cette procédure va s'avérer payante par la suite: une simple porte qui bouge, une seule fois, rien de plus, et voilà que ce délicieux frisson glacé, si prisé de tout fantasticophile qui se respecte, nous remonte soudain le long de l'échine, nous rétractant le testicule… Évidemment, ça ne va faire que croître et embellir, chaque manifestation de l'entité se confirmant plus inquiétante que la précédente, pour enchaîner le moment venu sur des effets-choc assez croquignolets, jusqu'à un climax final lors duquel il est impossible de ne pas bondir de son siège!
Précisons que, durant ces séquences, Peli ne joue jamais la facilité et évite soigneusement tout spectacularisme mal venu. Ainsi, et selon la fameuse distinction établie par Stephen King dans son essai "Anatomie de l'Horreur" (1), il joue en permanence sur le registre de la terreur, mais jamais sur celui de l'horreur. Selon une démarche assez similaire à celle d'un Shyamalan, on a dans "Paranormal Activity" une immanence du Mal, c'est-à-dire que celui-ci n'est jamais clairement identifié dans son essence, et que l'on n'aura jamais affaire qu'à des manifestions ou, pour poursuivre la comparaison, à des "phénomènes". On aura beau classifier ceux-ci artificiellement comme relevant d'un cas de possession, tout en les attribuant à un vague démon tout aussi hypothétique que mal défini, il n'en demeure pas moins que, pour ce que l'on en sait et pour ce que l'on nous en dit, on pourrait tout aussi être confronté à un cas d'hystérie tel que ceux décrits par Charcot à l'aube de la psychanalyse… La question reste donc en suspens quant à la responsabilité inconsciente de la victime dans l'avènement des "phénomènes", comme le suggèrent par ailleurs plusieurs scènes de somnambulisme…
Le Mal doit donc rester dans l'ombre pour être tout à fait terrifiant, car toute apparition du monstre (du latin "monstrare": montrer) aboutit irrémédiablement à sa "dé-monstration", soit: une perte conséquente de sa capacité à nous épouvanter. Dès lors, ce que nous montre la caméra "objective" de Peli ne saurait être que de l'ordre de la menace: par le fait, jusqu'au climax final (qui révèle à la fois tout et rien), les agressions effectives se déroulent toutes hors-champ, et l'on ne peut que s'émerveiller de l'insistance, presque humoristique, que met l'"agresseur" à trainer littéralement ses victimes hors de notre vue, comme pour s'assurer de pouvoir réaliser ses exactions en toute quiétude, à l'abri des regards indiscrets… Bien entendu, on ne manquera pas de souligner la thématique de l'éternelle frustration du voyeur: rappelons que, dès le début, l'acquisition de la caméra provoque une grande excitation chez le héros qui, l'œil collé à l'objectif, ne tarde pas à demander à sa fiancée de "retirer son soutif" pour obtenir in petto une fin de non-recevoir. Le drame du voyeur, c'est d'être persuadé qu'il y a quelque chose à voir là où il n'y a rien ou, plus précisément, là où il n'y a que son propre fantasme intangible. Pire: viendrait-il à voir quelque chose que son désir, en tant qu'assouvi, s'abolirait immédiatement pour fantasmer une vision au-delà de l'effectivement vu. Et c'est là que la promo se montre intelligemment roublarde: en ce qu'elle propose de voir l'inimaginable là où il n'y a objectivement rien à voir, et c'est précisément la raison pour laquelle le film présente, dans sa démarche "terroriste", de réels moments d'efficacité. Le trailer, de par son statut même d'enclancheur de désir, se garde bien de nous montrer quoi que ce soit, si ce n'est l'effet produit sur les spectateurs confrontés à ce que l'on a défini comme de simples "phénomènes", soit: des épiphénomènes! Et, par le fait, nous ne verrons rien, puisque tout est évacué hors-champ de la réalité objective filmée par la caméra, et surtout pas les seins de l'héroïne! Une phénoménologie qui permet d'affirmer, avec Kant, que le réel nous reste inconnaissable…
Ainsi, "Paranormal Activity" se situe bien dans une démarche illustrée par "La Maison du Diable" (1963), chef-d'œuvre inégalé de Robert Wise, sans en atteindre, en dépit de son efficacité, toute la puissance suggestive. La raison en est que Wise ne montrait ABSOLUMENT RIEN, si ce n'est des mouvements de caméras diaboliques soulignés d'une bande-son remarquable, là où Peli recourt tout de même, quoique parcimonieusement, à de l'effet visuel. Exemple: chez Peli, on voit bouger une porte, alors que chez Wise la porte bouge entre deux plans, c'est-à-dire dans le non-filmé. Le premier filme des phénomènes, le second se contente de nous confronter aux effets de phénomènes supposés. Et tout à l'avenant: l'entité de "La Maison du Diable" atteint son maximum de concrétion dans une scène où il nous est impossible de n'en rien voir, tout se déroulant dans l'obscurité (le Mal doit rester dans l'ombre), la caméra restant impitoyablement fixée sur le visage de l'héroïne, décomposé par l'épouvante, et la terreur atteint son comble dans la menace qui demeure interminablement tapie derrière une porte qui ne s'ouvrira pas… Cette même porte sert d'ailleurs de métaphore à Stephen King qui préconise, afin de différer le moment où la terreur va se dégrader sous la forme plus triviale de l'horreur, d'en repousser autant que possible l'ouverture, soit: le moment de ce que j'ai nommé la "dé-monstration". À cet égard, il est difficile d'aller plus loin que Wise, qui nous a donné la scène de porte définitive - il est vrai qu'avec "La Maison du Diable", on n'a pas affaire à du théâtre de boulevard! Mais on n'en retiendra pas moins qu'en dépit d'une différence d'approche de la "phénoménologie de la terreur", les deux films ont en commun de faire plus que suggérer une hystérie de leurs héroïnes respectives (immanence du Mal).
Puisqu'on en est au chapitre des "cinématographies comparées", il est une autre référence, quoiqu'inversée, que je ne peux pas décemment passer sous silence. Il s'agit du classique de William Friedkin "L'Exorciste" (1973), qui se retrouve naturellement en compétition avec "Paranormal Activity", du fait de leur statut commun de "paroxysme autoproclamé de la terreur". On est effectivement en présence de deux œuvres qui, indépendamment de leurs qualités intrinsèques, se reposent énormément sur la promo et sur le buzz, soit une volonté de mise en condition du spectateur en amont de l'expérience du film proprement dite. Ce qui revient à dire qu'avant même que d'entrer dans la salle, le public est déjà mort de peur sans avoir encore vu quoi que ce soit, un buzz parfaitement maîtrisé fonctionnant de façon à créer une autosuggestion chez les âmes non rompues à une certaine pratique de l'épouvante. Je puis vous en parler, qui ai vécu l'expérience de "L'Exorciste" en salle, lors de sa sortie française en 1974: hurlements hystériques des nanas, pâmoisons aggravées, spectateurs dégueulant partout, pompiers évacuant sur des civières les plus éprouvés, c'était pas rien, je vous assure… Ce qui explique que j'aie immédiatement calculé où la promo de "Paranormal Activity" voulait en venir, et l'effet d'autosuggestion qu'elle cherchait à (re)produire…
(Attention: spoilers…)
Mais la comparaison s'arrête là puisque, comme chacun sait, "L'Exorciste" est une œuvre plutôt démonstrative, là où "Paranormal Activity" joue au contraire sur la retenue. Ce qui n'empêche nullement Peli de se moquer gentiment du blockbuster de Friedkin, notamment en balisant toute la première partie de son film de fausses pistes, induisant des certitudes qu'il va se faire un plaisir de ruiner par la suite. Ainsi, lorsque l'on voit débarquer un médium, et que celui-ci fait allusion d'abord à un "démon", puis à un "spécialiste" de ce genre de cas, on s'attend à voir l'affaire tourner à un exorcisme en bonne et due forme, filmé façon reportage sur le vif. Mais l'exorciste tant espéré a tout de l'Arlésienne (parti en voyage, nous dira-t-on de manière expéditive…) et, quant au médium providentiel, il tournera les talons comme un foie jaune dès que les choses commenceront à virer à l'aigre, abandonnant nos héros dans la merde jusqu'au col! Entre-temps, le message est passé: si vous vous attendiez à voir un remake de "L'Exorciste" relooké Blair Witch, vous en êtes pour vos frais, et je vous ai bien eus!
Toutefois, au-delà des références que l'on pourra pointer cà et là, il est un lieu où "Paranormal Activity" se montre tout à fait original: dans la phobie même qu'il a décidé d'exploiter. Car le fait de filmer, de manière quasi warholienne (2), des gens en train de dormir, renvoie à cette angoisse universelle de la "tranche de mort" que représente le sommeil. Accepter de s'abolir, même provisoirement, dans le sommeil, c'est non seulement accepter de perdre le contrôle sur son environnement, mais également de s'offrir à l'autre (la caméra?) en toute vulnérabilité (3). "Paranormal Activity" joue donc à fond la carte de l'"hypnophobie" et rejoint ce faisant sa thématique principale, en définissant le regard posé sur le dormeur comme acte voyeuriste suprême. Aussi loin et aussi exhaustivement que je remonte dans ma vie de fantasticophile, je n'ai pas souvenance d'un précédent cinématographique, si ce n'est peut-être le chef-d'œuvre de Don Siegel "L'Invasion des Profanateurs de Sépultures" (1956), dont il est important de souligner que le titre envisagé originellement était "Sleep No More" - sous-entendu: de peur de vous réveiller "autre", aliénation du sujet illustrée dans "Paranormal Activity" par le somnambulisme de l'héroïne… C'est peut-être en ce sens qu'il faut entendre la menace inscrite sur l'affiche: "Bonne chance pour dormir après"…
Oui, "Paranormal Activity" est un film étonnant, à bien des égards… Je ne saurais donc trop vous inciter à y aller voir par vous-même, le film concocté par Oren Peli s'avérant, soyez en assurés, bien supérieur à ce que la promo et le trailer essaient de nous vendre. Au pire, vous vous en tirerez avec deux ou trois beaux moments d'authentique frayeur, et au mieux, vous serez enchantés par la richesse thématique et référentielle développée en filigrane par un réalisateur à suivre qui nous annonce déjà un second opus, intitulé "Area 51", et qui fleure bon son Roswell millésimé…
Dernière minute: une fin alternative?
Au sortir de la séance, discutant avec mon fils qui a vu le film avant moi, nous échangeons nos impressions. Nous sommes relativement d'accord, jusqu'à ce qu'il me sorte: "- …sauf la fin qui est toute pourrie!" Je m'insurge: "- 'tain, tu délires, là! J'ai fait un bond de deux mètres sur mon siège, si c'est ce que tu appelles une fin pourrie!" Mais il persiste. Je lui demande d'argumenter. Il me décrit alors une fin, qui me semble effectivement toute pourrie, mais qui n'a rien à voir avec ce que je viens personnellement de visionner. De concert, nous convenons n'avoir pas vu le même film… Si bien que je finis par lui demander: "- Mais tu l'as vu où, le film?" Il s'avère que le canaillou, pissant à la raie des directives présidentielles, l'a téléchargé je sais pas trop où sur la toile. Je comprends tout, et lui explique qu'il a certainement vu un piratage d'une quelconque sneak-preview, au cours de laquelle les spectateurs cobayes ont probablement dû s'insurger de même contre ladite fin, d'où une version totalement remaniée distribuée en salles. Tout ça pour signaler aux traqueurs de collectors - Patchworkman vous en donne plus! - qu'il existe une copie de travail du film qui tourne sur le Web, et qu'on retrouvera peut-être en bonus dans une future édition DVD…
Notes:
(1): "J'ai Lu" n°s 4410-4411
(2): Je pense notamment à "Sleep" (1963).
(3): Je ne résiste pas au plaisir de vous relater une parodie hilarante de "Paranormal Activity" récemment diffusée dans "Les Guignols de l'Info"… On y voit un couple endormi, filmé par une caméra de surveillance comme dans le film de Peli, lorsque soudain un bédouin traverse la chambre en tapinois, une baguette de pain sous le bras! La France a peur des Arabes qui viennent bouffer son pain durant son sommeil, mais comme elle dort, elle ne voit pas non plus ce que trament les Besson et autre Hortefeux!
Cliquez sur le lien pour voir la bande-annonce:
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18927592&cfilm=140608.html
Y'a pas un truc qui a bougé, là?
Putain, je te dis qu'il y a un truc qui a bougé!
Ah tu vois! elle a bougé, la meuf!